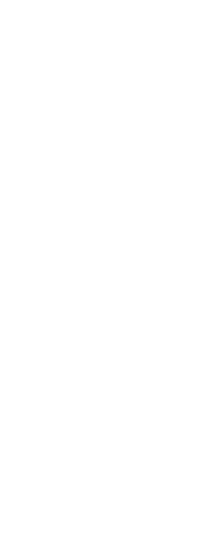Année 41, cinq jours avant la rébellion, fin de matinée.
J'ai toujours trouvé les débuts de journée fascinants. Tous ces gens qui s'activent et qui se dépêchent d'aller faire ce qu'ils ont à faire. Une danse pressée et organisée à la minute près ou presque. Il y a ceux qui n'ont aucun mal à se mettre dans le bain de suite. Eux donnent l'impression d'être sortis de leur lit frais et parés. Puis il y a ceux depuis lesquels s'échappe une certaine torpeur, dont les mouvements sont plus prudents, encore empreints de somnolence.
Je fais partie de cette dernière catégorie. Les réveils, que j'aie bien dormi ou non, sont en général d'un compliqué affligeant. Il me faut bien 30 minutes avant de réussir à ouvrir complètement les yeux et d'aligner deux mots réellement cohérents. C'est bien sûr sans compter les jours où Anton vient m'emmerder à l'aube avec ses exigences vestimentaires.
Ce matin n'a pas fait exception.
J'observe distraitement les Jaguars presser le pas autour de moi en grignotant une galette aux fruits secs que ma tante m'a forcé à prendre avant de partir. Je passe régulièrement rendre visite à ma famille avant le boulot ou après le repas du soir. Je compte sur les doigts d'une main le nombre de fois où je suis reparti les mains vides de chez eux. Elle m'a d'ailleurs retenu plus que d'habitude aujourd'hui : le soleil est plus haut dans le ciel qu'il ne le devrait.
Je suis en retard, alors je presse le pas vers le Centre. Je dois aider l'un des Commerçants à réparer et remonter son échoppe. Elle a été salement endommagée durant la nuit d'avant et les enfoirés s'en sont donné à cœur joie. J'arrive sur les lieux en moins de temps que d'ordinaire et ne perd pas de temps en conversation inutile. Je salue l'autre Jaguar, échange quelques mots avec lui puis la discussion se dirige vers la manière dont nous allons procéder.
Le soleil est bien plus haut dans le ciel à présent. Les travaux avancent considérablement et l'autre homme et moi discutons tranquillement de la dernière fête de l'orage. Je manque soudain de glisser de là où je suis perché et tente de m'appuyer contre la grande planche de bois qui fait partie du mur de l'échoppe. Une douleur aiguë explose instantanément dans ma main en même temps. «
PUTAIN DE BORDEL DE MERDE ! » Je retire vivement ma main et sens quelque chose s'en extirper. Je serre les dents alors que la douleur redouble d'intensité.
L'autre Jaguar est aussitôt à mes côtés mais je me concentre sur ma main, que je tourne vers mon visage. Il y a un trou au centre de la paume, duquel s'échappe une bonne quantité de sang. «
Fais chier... » Je relève les yeux et constate qu'un gros clou dépasse de la planche sur laquelle je me suis appuyé. C'est bien ma veine.
Je prends le mouchoir que me tend mon camarade et le remercie. J'essaie de bouger les articulations de mes doigts tout en pressant le tissu contre la blessure mais je retrouve dans l'impossibilité de le faire ou de refermer ma main. Ne parlons même pas de la douleur qui remonte dans mon bras et pulse tout le long.
Après un bref échange, je me retrouve donc l'obligation de quitter le coin des échoppes pour me rendre à l'hôpital. Je traverse la foule à pas rapides et grogne après une femme qui donne un coup dans mon bras et fait résonner la douleur le long des tendons et des terminaisons nerveuses endommagées dans ma paume. J'insulte mentalement les enfoirés qui ont cru drôle de mettre à sac l'échoppe ou ceux qui ne sont pas foutus de s'écarter. Je m'en prends même aux putains de gens qui sont pas capables de voir où ils foutent leurs mains – autrement dit, moi. Ça a au moins le mérite de m’empêcher de me concentrer sur la douleur palpitante.
Je passe enfin les portes du centre de soin et fais comme tout le monde : je prends un siège et j'attends qu'un des soigneurs viennent me voir. Il ne s'agit pas d'une urgence, malgré l'afflux important de sang. J'examine un instant la blessure mais replace rapidement le tissu pour ne pas mettre davantage de fluide sur le débardeur que je porte. Deux hommes entrent et mon regard se pose machinalement sur eux. Un frisson court le long de ma colonne vertébrale sans raison logique quand je reconnais l'inconnu qui garde son bras contre lui. Ce n'est pas la première fois que mon regard se retrouve attiré par lui ces dernières années. Je n'ai aucune idée de qui il est et je ne lui ai jamais parlé, pourtant, je dois me forcer à détourner les yeux pour ne pas provoquer de débats inutiles. Je préfère ne pas pousser la réflexion plus loin pour m'éviter tout mal de tête. Je garde donc mes yeux braqués devant moi et m'empêche de tourner la tête comme mon corps semble tant vouloir le faire, ce traître – c'est vrai qu'au final, le souci n'a jamais été lui, mais moi et mes angoisses handicapantes.
J'entends une soigneuse se présenter à l'un des patients et un coup d’œil me confirme qu'il s'agit de l'inconnu. Presque en même temps, une autre soigneuse se poste devant moi, un sourire poli aux lèvres. «
Bérénice, c'est moi qui vais m'occuper de toi. » Je hoche la tête en lui rendant son sourire. «
Raison de ta présence ? » Je m'apprête à répondre lorsque je crois entendre l'autre homme prononcé un mot qui me perturbe totalement... Est-ce qu'il vient de dire qu'il s'appelle « Orion » ?
Je tourne la tête vers lui alors qu'il répond à une autre question de sa soigneuse et je sens mon corps se figer. Je me force à l'inspecter plus en détails mais je ne reconnais pas spécialement l'enfant avec qui j'ai grandi, celui qui a longtemps hanté mes pensées. Le nœud qui s'est instantanément formé dans mon ventre ne se dénoue pas pour autant et je dois me forcer à déglutir tellement ma gorge s'est asséchée. Peut-être que j'ai juste mal compris ?
Je croise le regard de l'autre homme à cet instant et je suis incapable de détourner le regard.
«
Y a un souci ? » La question me sort de l'espèce de transe dans laquelle j'étais coincé et je bafouille légèrement en tournant la tête vers la soigneuse. «
P-Pardon ? » La jeune femme plisse les lèvres et elle a du mal à cacher son agacement. «
On va recommencer depuis le début, d'accord ? C'est quoi ton nom ? » Je lâche le mouchoir puis me passe une main dans les cheveux pour essayer de reprendre contenance. «
Je- Gio. Giovanni. » Et parce que je n'ai aucune prise sur mon comportement, je ne peux m'empêcher de vouloir voir la réaction de l'inconnu s'il entend mon nom. Je tourne la tête vers lui, l'appréhension et la peur au ventre.